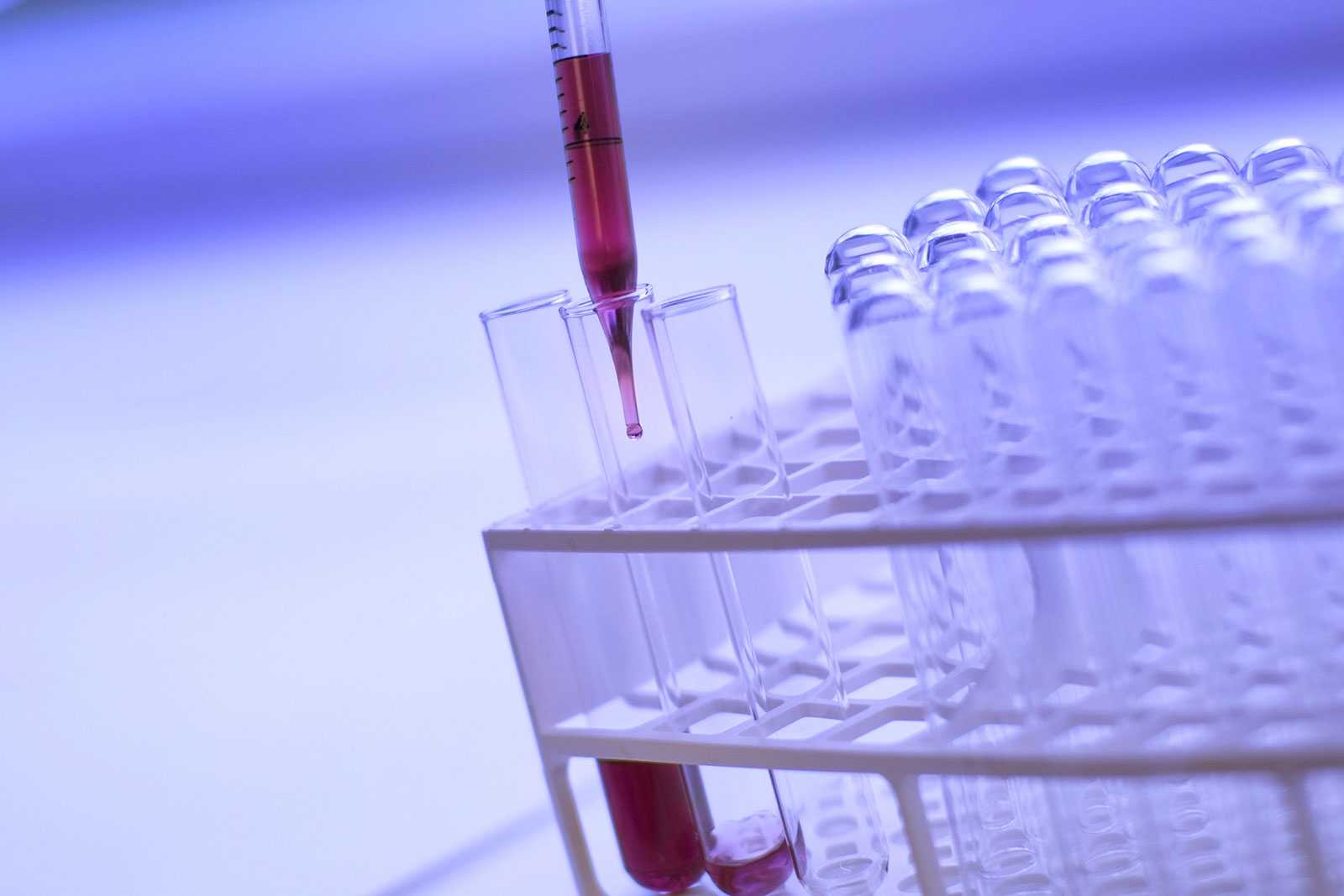L’expérimentation animale porte aussi préjudice à l’homme
13 janvier 2016
Un article passionnant émanant du service de presse de l’Université de Cambridge, publié sur le site du NCBI (National Center for Biotechnology Information) le 25 octobre dernier examine en détail les résultats récents d’études démontrant à quel point l’expérimentation animale constitue une impasse. Nous résumons pour vous cet examen extrêmement documenté.
On peut identifier deux types de recherche : la recherche fondamentale qui cherche à identifier des mécanismes et obtenir des données brutes, et la recherche appliquée dont le but est d’obtenir une application thérapeutique pour l’homme ou des animaux dans le cadre de la médecine vétérinaire.
Dans les deux cas, les résultats trompeurs issus de tests sur l’animal sont la norme aussi bien en matière d’études de sécurité, qu’en découverte de thérapies efficaces.
Il y a donc une trop forte mobilisation de la communauté scientifique sur des moyens trop peu efficaces par rapport à d’autres méthodes qui mériteraient plus d’attention.
On estime à 115 millions le nombre d’animaux utilisés dans le monde par la recherche biomédicale. Celle-ci devrait pourtant être evidence based (fondée sur des preuves) mais dans la réalité des laboratoires, c’est plutôt l’arbitraire qui domine.

L’influence de l’environnement
Les procédures expérimentales sur les animaux réalisées dans des conditions forcément artificielles impactent les résultats d’études.
Par exemple, une hausse du niveau de la cortisone a été constatée chez des primates voyant d’autres congénères subir une prise de sang sous la contrainte.
Constatée également une accélération de la pression sanguine et du rythme cardiaque chez des rats lorsque d’autres rats subissent une mise à mort par décapitation devant eux.
Même les procédures les plus habituelles (changement de cage – déplacement) élèvent les marqueurs de stress chez les animaux. De fait, tout cela peut confondre les données et interroge sur la qualité de celles-ci.
Discordance entre la maladie humaine et celle provoquée chez l’animal
C’est une certitude : la complexité d’une maladie humaine est impossible à reproduire chez un animal et limite l’utilité des modèles animaux.
L’exemple de l’AVC est frappant : c’est aujourd’hui une pathologie relativement bien comprise. Cependant en faire un modèle animal convenable reste illusoire.
Même la mise en place de lignes de conduites standardisées (appelées stair) dont le but est de limiter les écarts entre le modèle animal et le modèle humain n’a pas d’impact en termes d’essais cliniques (la phase de tests sur les patients humains)
Finalement le plus difficile est de recréer sur un animal les conditions pré-existantes, complexes et typiquement humaines qui, dans le cas de l’AVC, sont presque plus importantes que l’AVC en lui-même.
Les animaux ne développent pas spontanément l’athérosclérose (épaississement de la paroi des grosses artères et obstruction par des plaques d’athérome), un contributeur majeur dans la survenue de l’AVC. Pour recréer cette athérosclérose les chercheurs compriment les vaisseaux sanguins de l’animal ou insèrent des caillots de sang artificiel dans les vaisseaux.
Clairement, les causes contextuelles complexes d’un AVC humain ne sont pas reproduites.
Logiquement le fait que plus de 114 thérapies élaborées sur l’animal avec succès soient en échec sur l’humain n’est pas surprenant.
Les mêmes constats tombent pour le cancer, l’Alzheimer, ou encore la sclérose latérale amyotrophique (aussi appelée « SLA » ou « maladie de Lou Gehrig »).
Le modèle souris de cette pathologie est en état d’échec reconnu avec plus de 20 remèdes ne fonctionnant pas sur l’humain et un seul commercialisé offrant un bénéfice modeste.
Idem pour la recherche sur le traumatisme crânien : en 2010, une étude a démontré que sur 27 essais cliniques à grande échelle (phase 3) et 6 essais non publiés, toutes étaient en échec après des résultats encourageants sur les animaux.
Beaucoup d’énergie à vouloir créer de meilleurs modèles animaux
On remarquera que beaucoup d’énergie est déployée pour créer de meilleurs modèles animaux, ou pour invalider de facto des alternatives sans leur laisser la moindre chance. Mais quand on lit ce chiffre édifiant, selon la FDA (Food and Drug Administration) le taux d’échec d’un médicament candidat lors du passage à l’homme serait de 96% (en
hausse 2% par rapport à 2004) on s’aperçoit que c’est finalement le malade qui est oublié.
Cas où les modèles animaux fonctionnent
Même quand les modèles animaux sont bien représentatifs de la pathologie humaine étudiée, de grandes variations selon les lignées animales choisies (rats – souris) surviennent et jettent un doute sur les résultats.
Une étude a démontré qu’un traitement pour la lésion de la moelle épinière avait des résultats différents selon les lignées d’espèces choisies.
Il a été constaté que même des rats de même lignées mais achetés chez des fournisseurs différents ne provoquaient pas les mêmes résultats pour un test identique !
Actuellement aucun traitement neuroprotecteur destiné au traitement contre la lésion de la moelle épinière n’a vu le jour
En 2013 la conclusion d’une étude animale sur une maladie inflammatoire était sans équivoque
Notre étude soutient que la priorité maximale devrait être de se concentrer sur les conditions humaines les plus complexes de la maladie plutôt que de se reposer sur l’étude de modèle souris.
Nous savons que les différences génétiques inter espèces existent mais un sous-problème plus complexe encore apparaît : des différences d’expression de gènes identiques existent.
Ainsi, même l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés ne garantit pas l’expression d’une fonction du gène comparable chez la souris par rapport à l’homme. C’est parfois même l’effet inverse qui se produit comme lorsque la protéine qui contrôle le taux de sucre dans le sang humain a provoqué une perte de contrôle du taux de sucre chez la souris, une fois le gène humain inséré dans le génome de l’animal.
Le primate : la fausse bonne idée

Les mêmes critiques s’appliquent chez le primate. Bien qu’étant considéré comme un modèle très proche de nous. C’est avant tout un modèle psychologiquement rassurant mais souvent dépourvu d’intérêt.
Ainsi, une trop grande confiance en certains vaccins contre le VIH identifiés efficacement sur des primates ont conduit à faire prendre de gros risques à des patients humains.
Pour le vaccin gp120 : celui-ci n’arrivait pas à neutraliser le VIH dans des modèles cellulaires en culture, mais arrivait à protéger le chimpanzé. C’est donc cette deuxième hypothèse qui a été favorisée conduisant les chercheurs à lancer des études sur patients humains. Etudes ayant échouées avec un résultat similaire aux résultats du test in vitro préliminaire.
En 2006, 6 volontaires humains ont reçu un médicament immunomodulateur : le TGN1412.
Ce composé avait pour effet de moduler le système immunitaire. Quelques minutes après le premier essai, les volontaires ont subi de graves effets adverses mettant leur vie en jeu.
L’effet avait été identifié sur des modèles animaux dont des primates. Ces derniers avaient reçus des doses journalières 500 fois plus élevées que celles prévues pour un usage humain, pendant 4 semaines, dans le cadre d’essais toxiques à doses répétées.
Alors que le monde de la recherche découvre et explore chaque jour la complexité du vivant et les subtiles nuances biologiques qui en découlent, il est clair que le problème de la différence inter espèce prédomine largement par rapport aux éventuels bénéfices que l’on peut trouver comme de plus en plus de preuve le confirment.
La manière de métaboliser un médicament, la génétique, l’expression d’une maladie (induite ou artificielle) l’anatomie, l’influence du laboratoire, les différences entre différentes lignées d’un même animal – mécanisme physiologique : Comment déterminer avec justesse quel fait sera applicable à l’humain de celui qui ne le sera pas ?
Il est encore trop souvent admis par de nombreux scientifiques que l’obtention d’informations reste préférable à l’absence de données. Mais là aussi la question de la pertinence d’une telle affirmation se pose.
Des données trompeuses peuvent conduire la recherche dans des voies erronées ou encore vers l’abandon de voies thérapeutiques qui auraient pu être intéressantes pour l’humain.
Il est temps de mettre en place une réflexion juste et plus poussée pour une recherche plus efficace, avec de nouveaux outils. Il n’y a pas de temps à perdre : des malades attendent.
Retrouvez l’article complet en anglais avec les sources en cliquant ici
AG